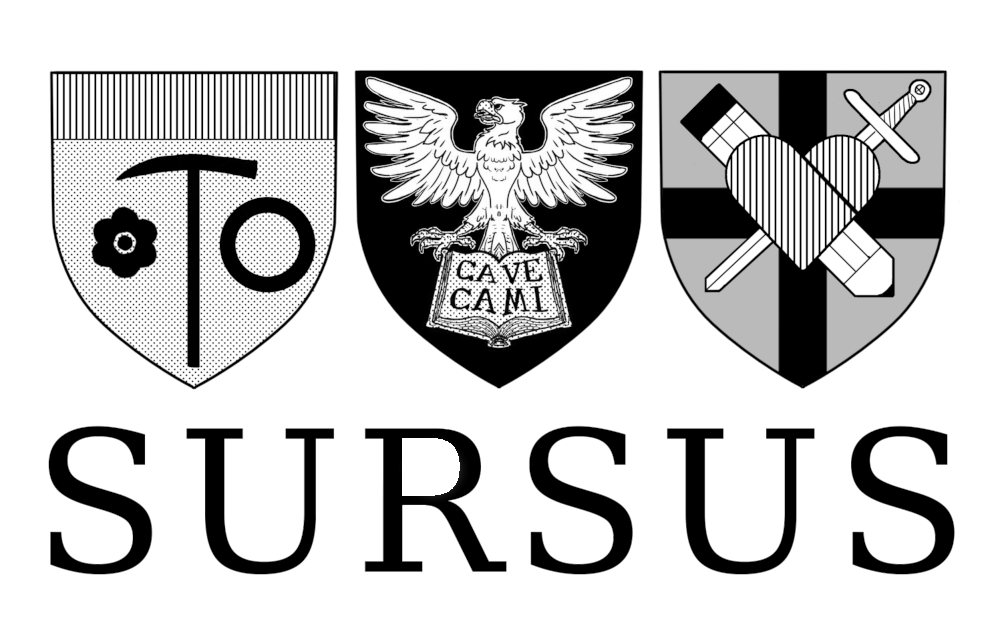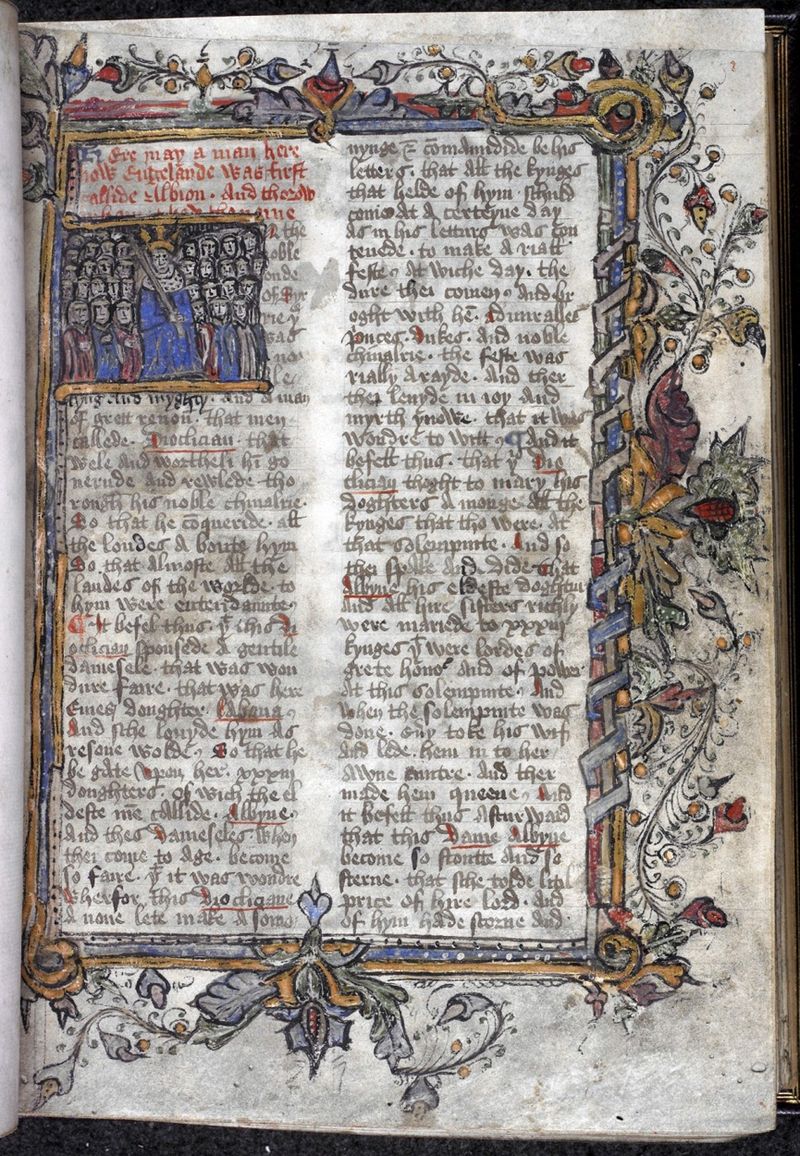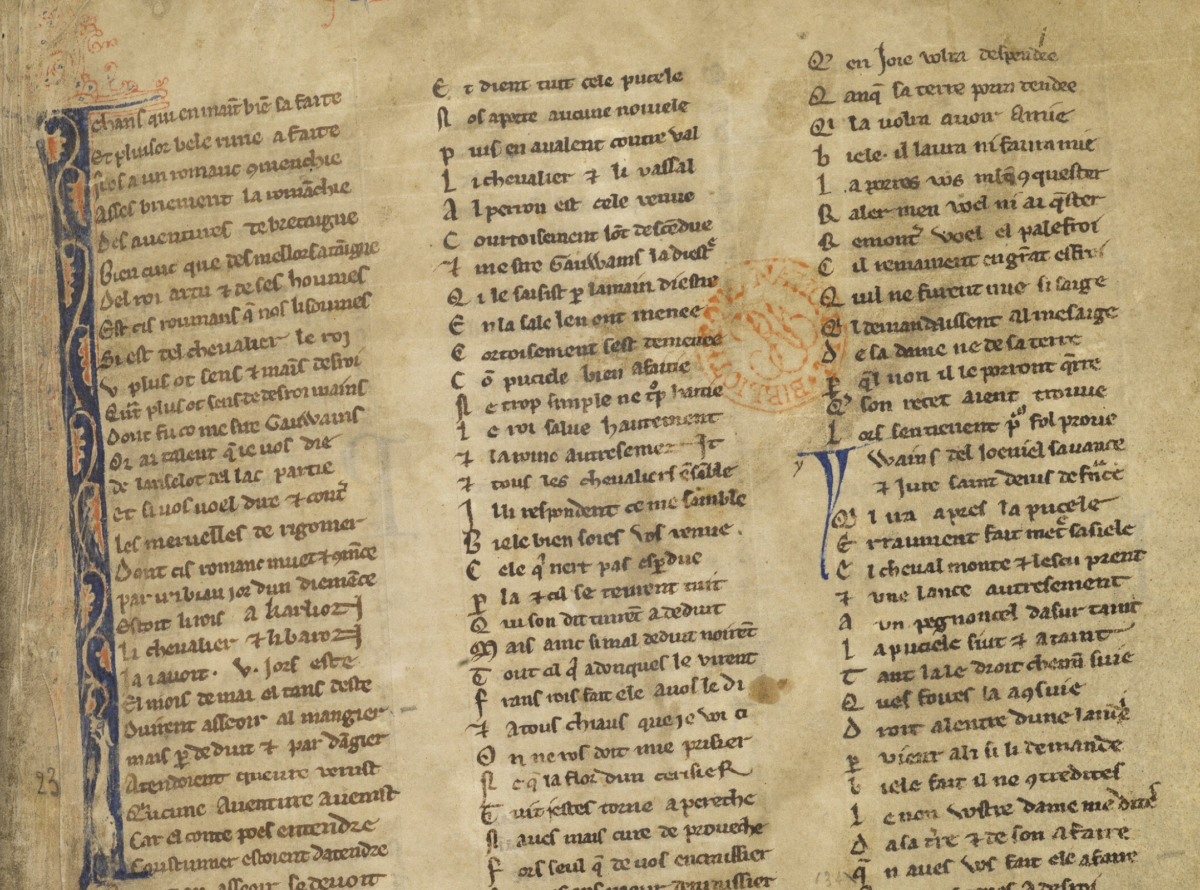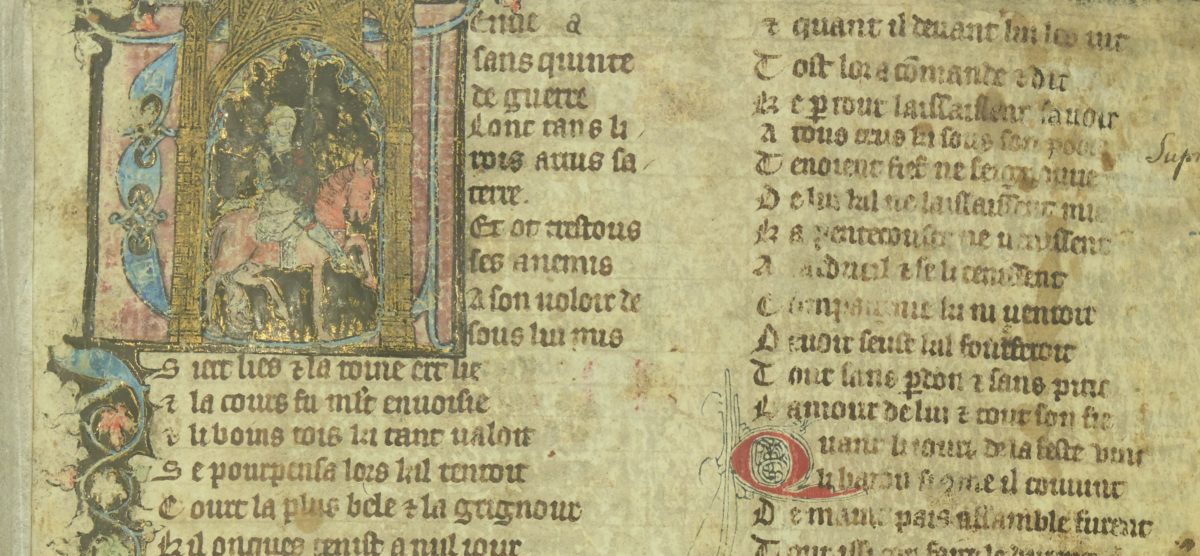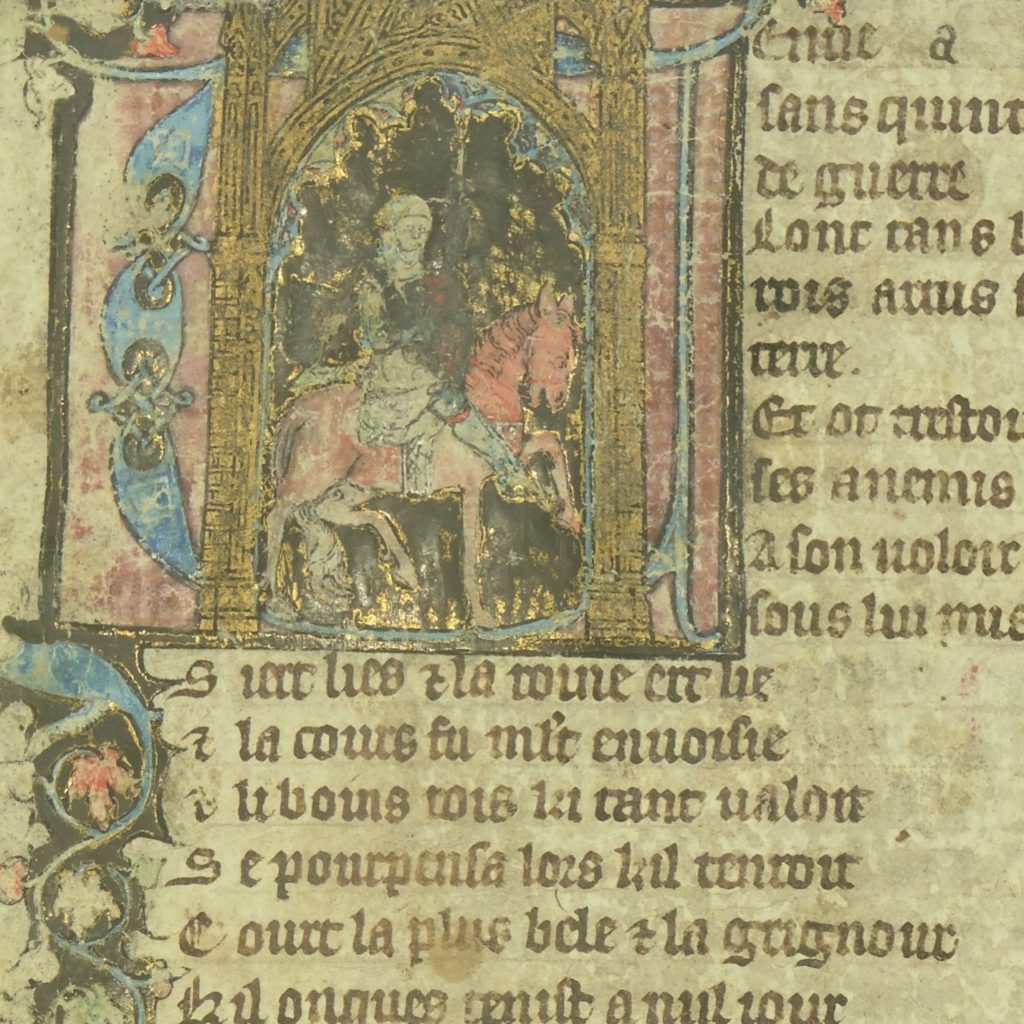À l’époque héroïque de l’histoire des religions, la question ne se posait presque pas : bien sûr que Noël vient d’une fête païenne, comme toutes les fêtes chrétiennes (même quand on n’a pas de trace de fête païenne antérieure) ! La pop culture, la vulgarisation et les journalistes le répètent encore inlassablement, ce contre quoi les spécialistes avaient dressé un mur de scepticisme très critique : est-ce que ces histoires d’origines païennes expliquent grand-chose ?
Il est vrai qu’elle nous font perdre du temps et sauter aux conclusions. Mais le mouvement de balancier en arrive au point où on traite ces hypothèses comme ridicules, alors qu’il y a parfois des éléments pour les soutenir. Il y a quelques années, notre vidéo sur Noël restait prudente, Noël et le Natalis Invicti apparaissant en même temps.
Mais est-ce toute l’histoire ? Ça ne semble pas une coïncidence qu’on ait fixé Noël à la date traditionnelle du solstice. Cette célébration solaire n’a-t-elle pas des racines plus anciennes ? Petit cadeau de Noël (ou de solstice) aux enthousiastes qui tiennent à dire que Noël a des origines païennes, Lays rouvre le dossier des fêtes du solstice, en trois parties, commençant par un rappel des grandes lignes des origines de Noël, et des précautions à prendre quand on navigue les calendriers de l’Antiquité et le cycle du soleil, de Yalda à Yule en passant par la machine d’Anticythère.
Documents
Script de la conférence (qui ne la suit que d’assez loin) :
Diapositives (PDF) :
Erratum
Partie II, 17:24 : La mention du novem solum semble mal attribuée à Ambroise de Milan, il s’agit plutôt d’un sermon de Maxime de Turin.
Partie 1 :
Deuxième volet de cette conférence sur Noël et le solstice. Que valent les théories astrothéologiques, qui postulent que les mythologies anciennes seraient essentiellement des allégories de phénomènes astronomiques ? Un code qui cacherait de simples mouvements des astres ? Une approche qui rassemble parfois esprits scientistes et publics mystiques… Lays revient ici sur la fête de la « naissance du soleil » mentionnée par le calendrier du pseudo-Antiochus, et quelques mentions d’auteurs antiques qui semblent placer une telle fête en Égypte aux alentours du solstice. Mais les très nombreux textes laissés par les Égyptiens confirment-ils leur histoire ? Est-ce que cela cadre vraiment avec ce que l’on sait des croyances et surtout du calendrier des anciens Égyptiens ? À croire qu’il va falloir regarder la troisième partie pour tirer tout cela au clair…
Troisième et dernière partie de cette conférence sur les fêtes du solstice. Et si, suivant une remarque de Macrobe, plutôt que de se concentrer sur la naissance du Soleil, on se tournait vers la croyance que les différentes phases de la vie du soleil (jeunesse, vieillesse, mort ?) étaient fêtées au fil de l’année ? La mention d’un « coucher de soleil » dans un mystérieux calendrier, consigné à l’époque byzantine pourrait éclairer l’étrange fête, apparemment tardive, des Brumalia, dont le nom dérive du solstice d’hiver (Bruma) mais commence un mois avant… S’agirait-il d’un moment particulier du cycle du soleil, où il passe dans l’hémisphère inférieur et… Et quoi ? Le soleil meurt ? Et renaît ensuite au solstice ? Ou se transforme en un autre dieu (Hadès, Dionysos, Saturne) ? Sa puissance astrologique diminue ? Il réchauffe les semences sous terre ? Creusant de l’astrologie babylonienne aux papyrus grecs magiques en passant par des fragments néoplatoniciens, Lays essaie d’ébaucher une conclusion malgré toutes ces conceptions qui s’affrontent.